Qui est Joe Bataan ? Un vétéran de la latin soul ? Le chantre du boogaloo ? Un précurseur du latino-rap ? Le spécialiste des covers ? Un survivant ? À la faveur d’une soirée ciné-concert à Paris en juin dernier, le pionnier new-yorkais donne ses réponses à Funk★U.
★★★★★★★
Funk★U : Vous êtes d’origine afro-américaine et philippine et vous avez grandi dans le Barrio. Quelles ont été vos influences musicales?
Joe Bataan : J’ai grandi dans le Barrio, le quartier latino d’East Harlem, mais je faisais déjà partie de la minorité. Je ne parlais pas l’espagnol et je ne connaissais pas la musique latine. Peu de foyers avaient la télévision à l’époque, la radio était la seule source de divertissement. La musique était présente partout : dans les confiseries, les magasins, elle jaillissait des fenêtres. Tu apprenais les chansons rien qu’en marchant dans la rue ! C’était une très belle époque pour grandir. Il y avait beaucoup moins de racisme que maintenant car, bien qu’il y avait une nette prédominance portoricaine, les Italiens, les Polonais, les Noirs et les Blancs se côtoyaient. On a grandi tous ensemble… Les styles de musique qui passaient à la radio étaient aussi plutôt limités, les auditeurs des différentes communautés n’ont exercé d’influence sur la diffusion que bien plus tard. Ainsi, on a commencé à entendre les toutes premières stations de radios « noires » comme WWRL ou WHAT qui passaient du rhythm’n’blues. Et progressivement, on est passé du rhythm’n’blues au rock. J’imitais tous les chanteurs du hit-parade, je connaissais toutes leurs chansons. Je devais avoir à peine neuf ans. C’est parce que j’ai grandi en écoutant toutes ces musiques diverses qu’elles m’ont influencé.
Est-ce que vos parents chantaient ?
Ils chantaient à la maison, mais rien de sérieux ni de professionnel. Mon père aimait beaucoup Jackie Wilson et adorait aller à l’Apollo Theater. Il ne parlait pas beaucoup, contrairement à mon afro-américaine de mère qui était « Madame-je-sais-tout-je-connais-tout-le monde » ! J’ai hérité d’elle la ténacité et une certaine agressivité. Elle m’a appris à ne jamais laisser tomber mes objectifs dans la vie.
Avec le recul, l’épisode Fania Records était-elle une bonne expérience? Quelle a été votre plus grande leçon ?
J’ai connu mes premiers succès grâce à Fania. Nous avons évolué côte à côte. J’étais l’un des premiers artistes du label avec Bobby Valentine et Willie Colón. J’ai été le premier à passer sur les ondes américaines puis sur les radios noires, la WWRL notamment. Les gens se demandaient : « Mais c’est quoi ce truc? C’est nouveau ? C’est qui ce mec ? Il chante en anglais mais les rythmes sont latinos ! ». On avait un pied dans les deux mondes, et ça, ce n’était pas à la portée de n’importe qui. C’est grâce à cette expérience que j’ai pu mener cette carrière internationale.
Pourquoi avoir choisi de reprendre le morceau de Curtis Mayfield « Gypsy Woman » en 1966 ?
C’était un accident. En réalité, je n’étais pas chanteur, mais pianiste. Un jour, il y avait un petit groupe qui répétait et je me suis pointé devant eux. J’ai planté mon couteau sur leur piano en disant : « Qu’est-ce que vous faites là, qui vous a autorisé à jouer ici ? À présent, c’est moi votre leader. Avec moi, vous allez avoir du succès ». Et c’est comme ça que je me suis retrouvé à la tête du groupe. Leurs parents n’étaient pas très enthousiastes. Ils me considéraient comme un criminel. Je dois dire que j’avais rencontré quelques déconvenues… Mais j’ai réussi à les convaincre et ils m’ont accepté. C’était le plus jeune groupe latino-américain, ils étaient âgés de 11 à 13 ans. On a sorti notre premier titre « Gypsy Woman », dont j’avais composé la musique. Lors de l’enregistrement, j’étais tellement nerveux que sans m’en rendre compte, j’ai chanté le premier couplet de la chanson de Curtis Mayfield. Pour ne pas perdre la face, j’ai poursuivi avec mon deuxième couplet comme si de rien n’était. J’étais un autodidacte de 22 ans et j’ai enregistré ce premier album en quatre heures, ce qui était totalement inédit à l’époque. Cela prouve qu’une équipe soudée peut faire mieux que les plus grands talents.
Vous avez aussi repris « Shaft » d’Isaac Hayes et « The Bottle » de Gil Scott-Heron. Pourquoi ces choix ?
Je suis très bon pour faire des reprises. Le secret, c’est le timing et le flair. Je savais ce que les gens aimeraient. J’ai toujours eu une longueur d’avance. Grâce à ma différence d’âge, je connaissais les chansons que personne n’avait jamais entendues. Pour « Gypsy Woman », peu de gens l’avaient entendue, donc pas de problème. Pour « Shaft », c’était une autre histoire. C’était un tube international, alors comment faire mieux? J’ai effectué des modifications de-ci de-là, changé les arrangements en y incorporant des rythmes latins. Avec ce morceau, j’ai acquis la réputation d’un chanteur latino qui reprenait des titres en y apportant son propre style. Quant à « The Bottle », c’est encore une autre histoire. Je suis désolé de dire ça, mais je savais que la maison de disques de Gil Scott-Heron était en train de faire faillite et qu’ils n’avaient pas les moyens de la sortir. Mais je voulais faire différemment, et plutôt que de la chanter, j’en ai fait un instrumental. J’ai enregistré ce morceau en une seule prise. C’est aussi avec cet enregistrement que David Sanborn a percé. Ensuite, Larry Levan l’a beaucoup passée dans la fameuse boîte Le Garage et boom, ça a fait un carton. Au bout d’une semaine, 20 000 exemplaires ont été vendus sans aucun passage en radio. C’est alors que j’ai eu une révélation : je n’avais même plus besoin de passer à la radio, mais de promouvoir mes morceaux dans les clubs. C’est à partir de ce moment-là que j’ai commencé à penser comme un cadre de maison de disque. Je maîtrisais l’aspect commercial, le marketing, la promotion, la composition, la production. Pourquoi aurais-je donc eu besoin d’une maison de disques puisque je pouvais me débrouiller tout seul ? J’étais bourré d’idées, en avance sur mon temps. Ce qui m’a manqué, c’était les finances. Malheureusement, quand j’ai eu l’argent, je l’ai dépensé stupidement. J’ai perdu beaucoup d’argent au jeu parce que j’aime prendre des risques. Mais par chance, ma femme était là pour veiller au grain. Elle m’a remis sur le droit chemin. Ce n’est que récemment que j’ai commencé investir dans la musique.
J’ai été très étonnée d’apprendre que « Rap-O Clap-O », sorti en 1980, était considéré comme le premier disque de hip-hop jamais sorti. Quelle est son histoire ?
Dans l’auditorium d’un centre pour les jeunes, des gamins dansaient, chantaient, battaient des mains. Il y en avait plus de mille qui avaient payé un dollar pour pouvoir rentrer. J’ai demandé aux deux DJ qui passaient le son : « Qu’est-ce que c’est que ce truc, est-ce que ça a un nom ? ». Ils ne savaient pas, l’appellation rap n’existait pas encore. Je me suis dit qu’il fallait que je sois le premier. Aussi, j’ai écrit la chanson, emprunté de l’argent à RCA, loué un studio et attendu les deux gamins qui ne sont jamais venus. Je pense qu’ils ne m’avaient pas pris au sérieux. Cela a finalement été ma chance puisque je l’ai chantée moi-même. Je me suis retrouvé rappeur à 40 ans ! J’ai tout de suite été persuadé que ma carrière allait être relancée.
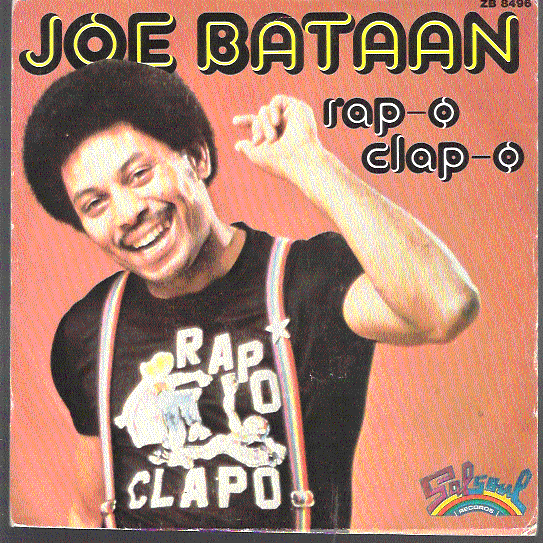 Quelque temps après la sortie aux USA, à ma grande surprise, RCA m’a demandé de partir faire une télé aux Pays-Bas parce que ça marchait là-bas. J’ai donc pris l’avion sans conviction et sans un sou. Pour 3 dollars 50, j’ai acheté des bretelles, un T-shirt sur lequel j’avais collé « Rap-O Clap-O » avec des étiquettes pailletées à 50 cents. J’avais pour finir mon pantalon noir et je suis allé à la télévision comme ça. Mais j’avais oublié mes chaussures. Il me restait juste une vieille paire de tennis jaunes et vertes. Et vous savez quoi ? Ça a fait sensation en Europe ! Tout le monde a commencé à imiter ce style, les jeunes se sont mis à porter des tennis colorées. Ensuite on m’a réclamé en France, en Allemagne. Au bout du compte, je ne suis rentré chez moi que six mois plus tard. L’album se vendait comme des petits pains. A cette époque, Sugarhill Gang et moi nous disputions les premières et deuxièmes places des charts. Le seul pays où je n’ai pas été classé, c’est en Angleterre parce qu’ils voulaient un pourcentage sur la chanson. Je les ai envoyé balader. Sans ça, j’aurais eu un succès encore plus grand. Malgré tout, trois millions d’exemplaires ont été vendus à travers le monde.
Quelque temps après la sortie aux USA, à ma grande surprise, RCA m’a demandé de partir faire une télé aux Pays-Bas parce que ça marchait là-bas. J’ai donc pris l’avion sans conviction et sans un sou. Pour 3 dollars 50, j’ai acheté des bretelles, un T-shirt sur lequel j’avais collé « Rap-O Clap-O » avec des étiquettes pailletées à 50 cents. J’avais pour finir mon pantalon noir et je suis allé à la télévision comme ça. Mais j’avais oublié mes chaussures. Il me restait juste une vieille paire de tennis jaunes et vertes. Et vous savez quoi ? Ça a fait sensation en Europe ! Tout le monde a commencé à imiter ce style, les jeunes se sont mis à porter des tennis colorées. Ensuite on m’a réclamé en France, en Allemagne. Au bout du compte, je ne suis rentré chez moi que six mois plus tard. L’album se vendait comme des petits pains. A cette époque, Sugarhill Gang et moi nous disputions les premières et deuxièmes places des charts. Le seul pays où je n’ai pas été classé, c’est en Angleterre parce qu’ils voulaient un pourcentage sur la chanson. Je les ai envoyé balader. Sans ça, j’aurais eu un succès encore plus grand. Malgré tout, trois millions d’exemplaires ont été vendus à travers le monde.
Bobby Womack disait que « If You Want Me to Stay » était sa chanson préférée malgré son relatif insuccès. Avez-vous une telle chanson dans votre répertoire ?
Oui, il s’agit d’ « Ordinary Guy ». Je l’ai enregistrée au moins neuf fois dans des styles différents : mambo, cha-cha, en anglais, en espagnol, en version R’n’B, bossa nova… Il y a même une version en hommage aux Philippins. Il y a aussi « The Prayer ». J’aime beaucoup cette chanson parce qu’elle touche les gens. Certaines personnes sont venues me voir pour me remercier de l’avoir chantée. Ça fait tellement de bien de savoir que l’on peut aider les gens. Quelqu’un d’autre m’a dit que j’avais du cran parce que j’interprétais cette chanson sur scène alors que les gens sont venus s’amuser, écouter de la musique et danser. Je connais peu d’artistes qui feraient ça, mais je me l’étais promis. J’ai été mis à l’épreuve au Danemark, car ce pays est une sorte de cité du porno où l’on tourne beaucoup de films X. Le manager responsable du concert a posé un véto catégorique : « Non, non, on ne veut pas de prière, on veut du boogaloo ! ». Je me suis demandé si j’allais me dégonfler, si j’allais être fidèle à ma parole ou laisser ce mec m’intimider auquel cas tout ce en quoi je crois serait bidon. J’ai fini par décider de la chanter. Des étudiants m’ont interviewé et m’ont demandé pourquoi je chantais ce morceau. Ils ont été très intéressés par ma réponse et m’ont dit espérer l’entendre durant le concert. Du coup, le manager m’a vivement encouragé à l’interpréter, « chante-la Joe, on la veut ! ».
Est-ce que la pratique de la payola existe toujours ? (NDLR : système de pots-de-vin distribués aux animateurs radios, une pratique courante dans les années 1950).
Oui en effet, mais sous une forme différente. A l’époque certains couillons ont été jetés en prison car on a pu retracer les chèques qu’ils avaient encaissés. Maintenant, ça existe d’une façon plus détournée, plus underground. Le dollar, c’est le mal. Le capitaliste rend cupide. Et la cupidité fait prendre plus de risques et fatalement, ça attire des ennuis. Tu trouves enfin la sérénité lorsque tu trouves la grâce de Dieu, tu n’as alors plus besoin de ces choses. Tu te rends compte que la vie est belle, tu es satisfait de ton sort car tu te plies à Ses règles, et tu es heureux d’être en vie. Lorsque tu arrives à atteindre cet état d’esprit, tu vis différemment. Attention, ne vous méprenez pas, j’aime toujours l’argent ! Je me suis rendu compte que même s’il ne me restait plus un sou, il me restait la vie. Je sais que je dois mourir un jour. Rien n’est dû. On peut avoir un accident demain et c’est fini. C’est pourquoi je délivre incessamment ce message à l’occasion de tous mes voyages. C’est une promesse que je me suis fait, passer le message divin aux gens. Cela m’a réussi car cela m’a permis d’accéder à un public totalement inattendu. Si mon message touche une personne, alors j’aurais fait quelque chose de bien.
Parlez-nous de votre tournée en Allemagne de l’Est aux côtés d’Angela Davis en 1973. Qu’est-ce que ce voyage vous a apporté ?
Ce voyage m’a montré une autre face du monde. Je n’avais pas la moindre idée de ce qui se passait là-bas. On m’a découragé d’y aller car c’était un pays communiste d’autant que j’étais accompagné d’Angela Davis qui était très impliquée dans le parti. Je m’étais produit au Yankee Stadium juste avant et ça n’avait pas été une très bonne expérience. J’avais donc besoin de changer d’air. En plus, je connaissais Angela pour avoir déjà joué avec elle. Je suis resté un mois à Berlin-Est et à Moscou et ça a été l’expérience de ma vie. J’ai vu les choses différemment. Quand j’étais à Berlin Ouest, c’était très coloré. Mais quand je suis entré dans le secteur communiste, tout est devenu sombre, gris et rudimentaire. La population était très jeune puisque les plus vieux avaient été tués durant la guerre. Ils avaient banni le racisme dans le pays et l’avaient rendu illégal. Lorsque je suis sorti de l’avion, les gens m’ont traité comme une star internationale parce que j’avais une afro et ils n’en avaient jamais vu auparavant. Tout le monde voulait toucher mes cheveux ! Je suis reconnaissant envers ce pays. J’ai même écrit une chanson, « Peace, Friendship, Solidarity », qui m’a valu une standing ovation comme je n’en avais jamais connue. Quand des années plus tard, je suis retourné en Allemagne unifiée, à Cologne, je leur ai raconté cette histoire et ils m’ont répondu : « Joe, nous y étions ». Quel rêve !
Quel est votre souvenir le plus vivace ?
Mon plus grand souvenir, c’est lorsque j’ai reçu une invitation émanant du Latin Center du musée Smithsonian à Washington DC. Ils avaient fait appel à moi parce qu’ils pensaient que j’avais établi un pont entre différentes cultures. Ils ont estimé que j’avais beaucoup œuvré pour la culture latino-américaine alors que je n’en fais même pas partie. Ensuite, la communauté afro-américaine s’est dit : « Hey, il est métis, on le veut aussi ». Et puis la communauté asiatique s’est manifestée puisque je venais des Philippines. Du coup, je me suis retrouvé avec trois sponsors ! J’ai joué là-bas et c’était super. Aujourd’hui, mon portrait figure au National Portrait Gallery parmi ceux de Michael Jackson et Duke Ellington. Je me suis dit : « Wow ! Qui aurait cru que ce gosse qui a fait de la prison, qui n’avait rien qui n’a jamais pris de cours de musique de sa vie aurait un jour son portrait au Smithsonian ! ».
Il y a-t-il un sujet qui vous tient à coeur dont vous souhaiteriez parler ?
J’écris un livre depuis 20 ans que j’espère finir en octobre. Je déteste écrire, mais parler, ça, je sais faire. Son titre sera Streetology. C’est mon mot. C’est quelque chose qu’on ne t’apprend pas à Oxford, à Cambridge, ni à la Sorbonne. J’ai hérité du sixième sens de ma mère. Je lui dois ma survie dans le Barrio à Spanish Harlem. On devrait mettre mon livre sur toutes les bibliothèques des jeunes afin qu’ils puissent le lire et réaliser que tout est possible, qu’il ne faut jamais abandonner.
Propos recueillis par Catwoman.








